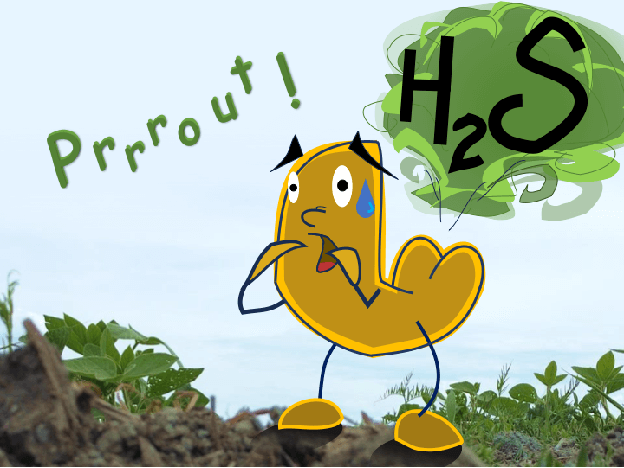La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie dégénérative qui affecte le système neuromoteur. Bien que relativement rare, la SLA entraîne des conséquences dramatiques : elle cause une paralysie progressive et des incapacités sévères, qui mènent éventuellement à la mort. C’est de cette maladie que souffrait le physicien britannique Stephen Hawking.
En raison de la gravité des symptômes, les patients atteints de SLA peuvent se questionner sur la pertinence d’entreprendre des démarches de réadaptation, trouvant celles-ci insignifiantes, voire futiles. Cette perception peut également être partagée par le personnel médical responsable de ces patients.

Le professeur Bernard Michallet du Département d’orthophonie de l’UQTR.
Conscientes de cette problématique, l’équipe d’intervenants et la direction du Centre de réadaptation de l’Estrie sont entrées en contact avec le professeur Bernard Michallet, directeur du Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Ce dernier a rapidement cerné l’enjeu qui lui était présenté.
« Dans ce contexte, on peut difficilement parler de réadaptation. Il s’agit plutôt d’un processus d’adaptation destiné à aider les gens à surmonter les incapacités qui apparaissent progressivement. Évidemment, cela est difficile pour les patients, mais ça l’est aussi pour les intervenants. Ces derniers savent qu’ils ne font qu’amoindrir le déclin en attendant l’inévitable », explique-t-il.
Une avenue positive
Pour remplir le mandat qui lui avait été confié, M. Michallet a réalisé une étude exploratoire sur la résilience en réadaptation de la déficience physique. Cette expérience consistait à mettre en place un programme basé sur les principes de la psychologie positive, telle que définie par le psychologue américain Martin Seligman.
« Notre programme de réadaptation encourageait les intervenants à soutenir les personnes avec lesquelles ils travaillaient. Tous les intervenants, qu’ils fussent travailleurs sociaux, psychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes ou psychoéducateurs, ont été formés à l’approche de la psychologie positive. Nous étions ainsi en mesure de déterminer si notre programme pouvait améliorer la résilience des patients », indique le professeur.
La psychologie positive est basée sur cinq piliers, qui sont regroupés sous l’acronyme PERMA (Positive emotion, Engagement, Relationships, Meanings et Accomplishments). Le premier pilier consiste essentiellement à amener le sujet à éprouver des émotions positives. Dans cette optique, toute activité permettant aux gens de vivre des moments de plaisir, comme aller voir un film ou manger une crème glacée, est à considérer.
Le second pilier de la psychologie positive est l’engagement, qui correspond à la notion de flow. Cet état mental survient quand une personne est plongée dans une occupation qui la passionne au point de se trouver dans un état de concentration maximale. Le fait de vivre cette expérience libère plusieurs hormones, notamment des endorphines, qui procurent un sentiment de bien-être à la personne.
Les relations interpersonnelles positives constituent le troisième pilier de la psychologie positive. Selon Seligman, la proximité des patients avec des gens dont la présence est bénéfique pour eux augmente considérablement leur qualité de vie.
Le quatrième pilier de la psychologie positive concerne le sens que l’on donne la vie. L’attitude avec laquelle on fait face aux situations d’adversité a une influence sur la perception de la vie. Avec une attitude positive, il est possible de tirer certains enseignements des expériences difficiles auxquelles on a été confrontées.
Enfin, le cinquième et dernier pilier de la psychologie positive est l’accomplissement. Cette dimension est orientée sur les réalisations, puisque la réussite procure des sentiments reliés à la fierté et au bonheur. Il peut s’agir de petites ou de grandes réalisations, comme faire une recette, publier un livre, peindre une aquarelle, marcher 5 km, etc.
Tirer des apprentissages
Pour réaliser l’étude, M. Michallet et ses collaborateurs ont dû recruter des patients atteints de SLA. Étant donné la nature et la rareté de la maladie, les chercheurs ont constitué un échantillon de quatre participantes, qu’ils ont évalué avant et après avoir intégré la psychologie positive à leur programme. Bien que l’échantillon soit trop petit pour généraliser les résultats, le professeur a réussi à faire ressortir certaines tendances.
« Chez deux de nos participantes, quasiment tous les aspects (sens de la vie, résilience, indice de dépression, bien-être psychologique, etc.) s’étaient améliorés. Pour ce qui est des deux autres participantes, l’une d’entre elles est demeurée stable, alors que l’autre a noté une détérioration de chacun des critères. Le programme ne semble donc avoir eu aucun effet sur elle ; toutefois, il faut préciser que la participante était aux prises avec la maladie depuis déjà deux ans. Bref, les résultats sont mitigés, mais on peut quand même penser que notre programme peut être quelque chose d’intéressant », soutient le professeur.
Afin d’obtenir une vision d’ensemble, l’équipe de M. Michallet a aussi interrogé les intervenants du Centre de réadaptation de l’Estrie, afin de savoir ce que l’introduction de la psychologie positive avait changé pour eux.
« Ils ont trouvé l’approche très intéressante, parce que ça leur a permis de voir leurs patients non pas comme des cas cliniques, mais comme des personnes ayant une vie au-delà de la maladie. Aussi, cela les a amenés à se parler davantage entre eux, de manière à mieux se partager l’information au sujet des patients qu’ils traitaient. D’ailleurs, la fluidité de l’information semble avoir grandement bénéficié aux patients », commente-t-il.